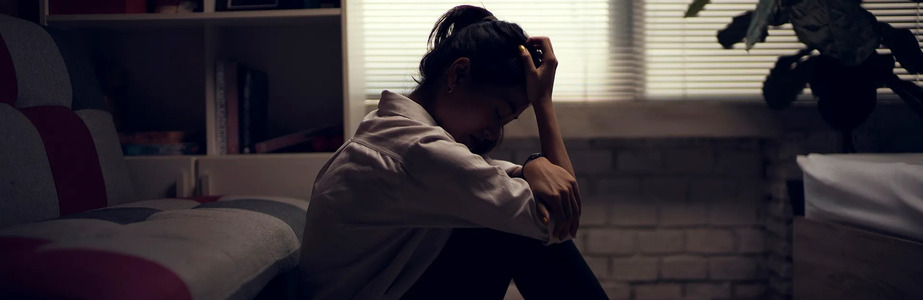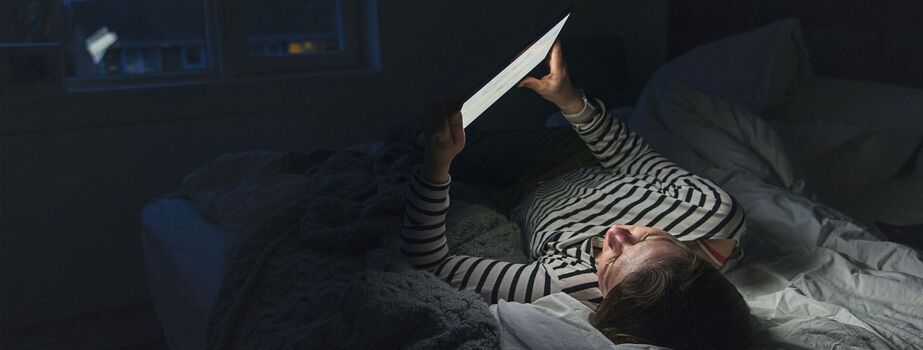Article rédigé pour La Revue [DEMOS] France
“Nomen est omen”, autrement dit “le nom est présage”. Cette locution latine évoque la conviction selon laquelle le destin d’un individu serait inscrit dans son nom. Au-delà de toute croyance, le prénom représente toutefois bien plus qu’une simple étiquette : il participe à la construction de l’identité sociale dès la naissance. Une étude menée par les économistes Saku Aura et Gregory D. Hess a mis en évidence que certaines caractéristiques des prénoms – telles que leur orthographe, leur origine culturelle ou leur degré de rareté – peuvent significativement présager le statut social, le niveau d’études ou encore le salaire de la personne.
Le prénom, un marqueur social inconscient
Depuis la loi française de 1993, les parents peuvent librement choisir le prénom de l’enfant et ne sont plus limités aux calendriers ou aux figures historiques. Cette évolution législative a transformé le prénom en un véritable phénomène de mode et en un marqueur de classe sociale. Il reflète désormais des dimensions culturelles, sociales et religieuses. De ce fait, il incarne l’identité sociale de l’individu et in fine, influe sur la manière dont il est perçu par autrui, en renvoyant inconsciemment à des idées préconçues sur ce à quoi s’apparente la personne. En société, un prénom tel que Brandon ou Jennyfer ne suscitera probablement pas la même perception que Charles ou Constance. Par conséquent, ces appréciations peuvent jouer un rôle prégnant dans le développement de la personnalité, les choix de vie, la trajectoire professionnelle ou encore sur le parcours scolaire.
Une influence sur les résultats scolaires
Une étude menée par le sociologue Baptiste Coulmont a permis de classer les prénoms de 350 000 lycéens en fonction de leurs résultats obtenus au bac. Les données indiquent que les élèves prénommés Côme et Madeleine ont une probabilité supérieure à 25% d’obtenir la mention « très bien », tandis qu’elle est d’environ 15% pour Apolline et Hortense. À contrario, Cindy, Steven et Mélissa affichent des taux inférieurs à 3%. Cette corrélation suggère que le prénom peut être révélateur des attentes éducatives et du milieu social auxquelles il est associé.
Quand le prénom façonne la trajectoire professionnelle
À curriculum vitae équivalent, un candidat portant un prénom tel que Kévin aurait jusqu’à 30% de chance en moins d’être embauché qu’un candidat prénommé Arthur, selon le directeur de l’Observatoire des discriminations. De surcroît, le site de recrutement TheLadders, en analysant une base de données de six millions de membres, déclare que les prénoms courts semblent bénéficier d’un avantage dans le monde professionnel. La musicalité et la mémorabilité du prénom peuvent ainsi constituer des facteurs de succès, notamment lorsque le candidat vise un poste à responsabilités, en facilitant les interactions et les connexions interpersonnelles.
Le choix du prénom dépasse ainsi la simple appellation. De manière subtile mais réelle, il peut conditionner des opportunités, des relations et des stéréotypes. Il s’inscrit alors dans un dialogue constant entre individualité et normes sociales. Comme l’affirment Philippe Besnard et Guy Desplanques, auteurs de l’ouvrage La cote des prénoms, « le prénom tend à devenir l’élément fixe et central de notre identité sociale».